« Pour innover réellement, il faut parfois construire à côté » (Tawhid Chtioui, Aivancity)
« Notre rôle, en tant qu’éducateurs, a changé. Il ne s’agit plus de former les étudiants à un monde stable, mais de les préparer à l’inconnu, à la complexité, à l’ambiguïté », déclare Tawhid Chtioui
 Fondateur et DG @ CCCLX • Fondateur et DG @ aivancity school of AI & Data for Business & Society
Fondateur et DG @ CCCLX • Fondateur et DG @ aivancity school of AI & Data for Business & Society
président fondateur d’Aivancity, école de l’IA
Intelligence artificielle
, et de CCCLX, école IT, dans un entretien à News Tank, le 27/08/2025. L’ancien DG
Directeur(rice) général(e)
d’EMLyon revient sur son parcours entrepreneurial dans l’enseignement supérieur, en France et au Maroc où il préside le CA
Conseil d’administration
du groupe Edvantis (ISGA).
« Pour innover réellement, il faut parfois construire à côté. Et montrer que d’autres modèles sont possibles. Je l’ai vécu personnellement en 2019 : après avoir obtenu l’aval du conseil de surveillance d’EMLyon pour lancer un projet d’école dédiée à l’intelligence artificielle, le cap a finalement été écarté. Avec Aivancity, nous avons cherché à créer un lieu qui ne demande pas l’autorisation pour changer les choses. »
Interrogé sur l’avenir des écoles de management, il estime qu’elles doivent se « repenser en profondeur. Le monde a changé, et avec lui, la nature même des compétences attendues ».
Plus largement, dans l’enseignement supérieur, « on parle souvent de transformation, mais on transforme rarement l’essentiel : les grilles de lecture, les postures académiques, les systèmes de reconnaissance ». Pour Tawhid Chtioui, « il manque aussi une véritable audace d’hybridation ».
Quant aux partenariats entre la France et l’Afrique, et au Maroc en particulier, il déclare : « La France a une carte à jouer, à condition de passer d’une logique de transmission à une logique d’écoute. L’Afrique n’attend pas de solutions : elle est déjà en train de les inventer. »
Un parcours fait de « bifurcations intérieures »
Vous avez débuté votre carrière à Dauphine puis Reims Management School (aujourd’hui Neoma) au début des années 2000. À quoi ressemblait une grande école de commerce à l’époque ?
Quand je suis entré pour la première fois dans une grande école de commerce, j’ai eu l’impression d’un lieu structuré, mais figé. Tout semblait ritualisé : amphithéâtres silencieux, grilles de notation immuables, étudiants en costume, PowerPoints standardisés.
Je savais que je ne ferais pas carrière dans le modèle traditionnel »J’enseignais alors le contrôle de gestion et l’audit, au cœur d’un système centré sur l’efficacité. On y parlait d’excellence, rarement de sens ; on formait des “winners”, plus que des esprits critiques. L’éthique était périphérique, l’économie réduite à la performance.
Je venais avec des lectures plurielles, une curiosité pour l’humain derrière les modèles, et l’envie de provoquer le débat. Ce que j’ai perçu, c’est une valorisation de la reproduction plus que de la rupture. Ce n’était pas un rejet, mais un appel à inventer autre chose : une école où l’on apprendrait à devenir libre de penser, de douter, d’agir.
Peut-être qu’Aivancity est née ce jour-là. Je savais en tout cas que je ne ferais pas carrière dans le modèle traditionnel, mais cette expérience m’a appris à conjuguer la rigueur des systèmes avec le désordre créatif.
Quels moments ont été décisifs dans votre parcours avant de rejoindre EMLyon, en 2016 ?
Plusieurs moments ont façonné mon parcours, non pas comme une ligne droite, mais plutôt comme une série de bifurcations intérieures.
La thèse m’a appris cette patience intellectuelle »Le premier déclic, c’est sans doute ma thèse. Elle portait sur une relecture du contrôle de gestion comme modèle communicationnel, à la croisée des sciences de gestion, de la communication, de la sociologie et de la finance. Plonger dans la recherche, c’était choisir la profondeur plutôt que la vitesse. J’y ai appris à douter, à formuler les bonnes questions plutôt qu’à rechercher des réponses toutes faites. C’est là que j’ai compris que le savoir n’a de valeur que s’il est partagé et mis en tension avec le réel. Cette exigence me guide encore aujourd’hui : si je parviens à inscrire mes projets dans le long terme, c’est parce que la thèse m’a appris cette patience intellectuelle.
Ensuite, il y a eu mes premières responsabilités pédagogiques et académiques dans des environnements très divers, en France et à l’international. J’ai enseigné en Égypte, en Russie, au Sénégal, en Chine…. Ces expériences m’ont beaucoup appris.
Un autre moment marquant a été ma participation à un programme très sélectif à la Harvard Graduate School of Education. Il réunissait 13 participants de 10 nationalités différentes. C’était un petit format, mais d’une qualité exceptionnelle. Certains enseignants étaient des conseillers du président Obama. On y abordait des enjeux fondamentaux liés aux sciences de l’éducation et au pilotage de l’enseignement supérieur, qui y est considéré comme une discipline à part entière.
En 2016, vous devenez DG
Directeur(rice) général(e)
d’EMLyon Africa et, en 2019 président du directoire. Vous succédez à Bernard Belletante
![]() Président Fondateur @ Trajecthoard
Président Fondateur @ Trajecthoard
au moment où l’école change de statut…
Ce fut un tournant majeur, mais aussi une épreuve initiatique. Diriger une école aussi emblématique, profondément ancrée dans un écosystème régional ancien, ne consiste pas seulement à porter une vision. C’est composer en permanence avec des forces contraires : ambitions économiques, héritages locaux, intérêts politiques, inerties internes. Très vite, le métier change.
Il ne s’agit plus de penser, de créer, d’impulser, mais de gérer, d’arbitrer, de négocier chaque souffle d’innovation contre des millimètres de consensus.
Vous aviez eu le temps de vous préparer à devenir numéro un, mais vous avez démissionné rapidement. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
L’école avait profondément muté »On peut se préparer à tout. Mais on ne choisit pas toujours le contexte dans lequel on est appelé à exercer. J’étais prêt à prendre la responsabilité. Mais ce qui a changé, ce n’était pas ma posture, c’était le cadre dans lequel cette posture devait s’incarner. L’école avait profondément muté : nouveau statut, nouvelle gouvernance, nouveau rapport aux parties prenantes. Et ces mutations n’étaient pas simplement des ajustements techniques. Elles redessinaient en profondeur le sens même du projet.
J’ai vu apparaître un écart grandissant entre ce que je portais comme projet académique et humain, et les logiques qui prenaient le dessus. Et à un moment, il faut choisir : rester et composer avec des compromis qu’on ne peut plus justifier… ou partir pour rester fidèle à ce qui nous fonde.
Qu’en avez-vous retiré ?
J’avais sans doute le salaire le plus élevé de l’enseignement supérieur en France »J’ai beaucoup appris. Sans cette expérience, je n’aurais sans doute pas pu créer Aivancity. J’ai accepté de repartir de zéro.
À l’époque, j’avais sans doute le salaire le plus élevé de l’enseignement supérieur en France. J’avais atteint ce que beaucoup considèrent comme une forme de sommet. Mais j’ai choisi de mettre cette position, cette sécurité, entre parenthèses pour construire un projet aligné avec mes convictions. Et oui, j’y ai mis tout ce que j’avais — pas seulement financièrement, mais intellectuellement, humainement, presque existentiellement. Parce qu’à un moment, on ne peut plus simplement faire carrière. Il faut faire œuvre.
Les nouveaux challenges éducatifs : « Les étudiants ont profondément changé »
Comment avez-vous vu évoluer les étudiants, en termes de profils et d’attentes ?
J’étais début juillet au Maroc, où j’ai rencontré les représentants de nos écoles du Groupe Edvantis et de ses 2 400 étudiants. Pour moi, il est impossible de diriger une école sans dialoguer directement avec eux. J’apprends énormément à leur contact. C’est en restant connectés à leur réalité que nous restons jeunes, en tant qu’éducateurs.
Les étudiants ont profondément changé. Et c’est heureux. Quand j’ai commencé, beaucoup voulaient « réussir leur vie ». Aujourd’hui, ils veulent réussir avec la vie. Ils posent des questions que leurs aînés évitaient : À quoi cela sert-il ? Pour qui est-ce que je le fais ? Est-ce que je vais être utile ou complice ?
Une génération hybride, critique, plurielle »Ils sont moins fascinés par les titres que par le sens. Moins obsédés par la réussite que par l’impact. Et surtout, ils ont grandi dans un monde fracturé, entre crise climatique, tensions géopolitiques, irruption de l’IA, incertitudes permanentes, mais ils avancent quand même, avec courage, avec lucidité, parfois avec colère. Ils ne veulent pas s’insérer dans le monde tel qu’il est. Ils veulent le réparer, parfois même le réinventer.
On les appelle parfois la génération K. Ce que j’observe, c’est une génération hybride, critique, plurielle, qui refuse les cases et les discours préfabriqués.
Cela change quoi pour les enseignants et les institutions ?
Notre rôle, en tant qu’éducateurs, a changé avec eux. Il ne s’agit plus de les former à un monde stable, mais de les préparer à l’inconnu, à la complexité, à l’ambiguïté.
Et s’ils nous bousculent parfois, tant mieux. Ce sont eux qui nous empêchent de devenir vieux de l’intérieur. Ils attendent des coachs, pas des enseignants ; des espaces de coworking, pas des salles de classe figées.
Cela implique de repenser le projet pédagogique. J’investis aujourd’hui beaucoup plus dans l’expérientiel que dans les contenus, qui constituaient jadis l’attente centrale. Ce que je cherche à transmettre, ce n’est pas seulement du savoir, mais une capacité à douter, à interroger, à se construire dans l’incertitude.
Beaucoup d’enfants et d’étudiants s’ennuient profondément dans nos écoles et universités »Le vrai sujet, c’est le sens de l’éducation. Comment fait-on grandir les personnes ? Le système éducatif doit être complété pour leur permettre d’exister pleinement car beaucoup d’enfants et d’étudiants s’ennuient profondément dans nos écoles et universités, confrontés à un enseignement trop académique, trop linéaire, trop éloigné de leurs aspirations.
Vous soulignez la nécessité de former des profils “360” : qu’entendez-vous par là et comment en former davantage ?
Former des profils “360”, c’est former des esprits capables de comprendre un problème dans sa globalité, de dialoguer avec plusieurs mondes, et d’agir avec conscience alors que notre système reste trop segmenté, académisé, verticalisé.
On continue à cloisonner les savoirs, à opposer technique et réflexivité, métier et sens, ingénieur et philosophe. Résultat : on forme des spécialistes brillants, parfois démunis face à la complexité ou incapables d’innover autrement.
Ce qu’il manque ? Des ponts. De véritables espaces d’hybridation. Des pédagogies qui encouragent l’interdisciplinarité, la créativité, l’utilité sociale. Et des modalités d’évaluation qui valorisent autant la compréhension globale que la maîtrise technique.
Il manque aussi de la confiance dans des profils atypiques. Ceux qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui, demain, sauront penser l’IA en citoyens, piloter un projet en humanistes, ou coder en mesurant les conséquences éthiques de chaque ligne.
Nous formons aujourd’hui des jeunes à exercer des métiers qui n’existent pas encore, à résoudre des problèmes dont nous n’avons pas encore conscience, avec des outils qui n’ont pas encore été inventés. C’est pourquoi nous avons intégré une “mise à jour du diplôme” à notre modèle : une possibilité pour les diplômés de revenir se former gratuitement, quelques années plus tard.
Son intérêt pour l’IA : « Je pressentais un changement de paradigme »
Comment s’explique votre passage des sciences de gestion et des écoles de management vers les sujets technologiques, et notamment l’intelligence artificielle ?
Ce n’était pas un virage. C’était une mue. Une lente transformation intérieure, nourrie par une intuition devenue conviction : le monde que l’on enseignait dans les écoles de management n’existait déjà plus.
Je ne conçois pas la direction d’une école sans une maîtrise des fondamentaux économiques. Heureusement, j’ai commencé par le contrôle de gestion : cela m’a donné une base solide pour piloter convenablement une institution. J’ai longtemps été immergé dans les sciences de gestion. J’y ai appris la rigueur, les modèles, la logique des organisations.
En 2018, j’ai écrit le premier projet d’une école dédiée à l’intelligence artificielle »Mais un jour, j’ai compris que le moteur du changement ne se trouvait plus dans les marges des tableaux Excel, mais dans les lignes de code. Que les décisions ne seraient plus seulement prises par des comités, mais de plus en plus souvent par des algorithmes. Et que l’éthique, la stratégie, la gouvernance, allaient devoir être réinterrogées à la lumière de cette intelligence nouvelle qui infiltre toutes les dimensions de notre société.
En 2018, j’ai écrit le premier projet d’une école dédiée à l’intelligence artificielle. À l’époque, beaucoup y voyaient un simple effet de mode. Or ce que je pressentais, c’était un changement de paradigme. Un basculement intellectuel et civilisationnel.
L’IA n’est pas un outil. C’est une mutation profonde de nos manières de comprendre, de décider, d’agir. Continuer à enseigner le management sans en mesurer les implications revient à former des navigateurs sans jamais leur parler du climat.
Alors j’ai décidé de me remettre en question. Et au bout de ce chemin, il y avait Aivancity.
Les écoles de commerce sont-elles menacées par les évolutions que vous décrivez ?
Les écoles de management ne sont pas menacées… à condition de se repenser en profondeur. Le monde a changé, et avec lui, la nature même des compétences attendues. Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de certains formats traditionnels.
Le management ne doit plus être enseigné comme un savoir séparé »Peut-on encore justifier un investissement de 70 000 euros et cinq ans de formation en management, sans repenser en parallèle l’utilité, l’agilité, et l’impact de ce que l’on transmet ? Je ne le crois pas. Le management ne doit plus être enseigné comme un savoir séparé, mais comme une compétence intégrée à tous les métiers. Une grammaire commune plutôt qu’un métier en soi.
De ce point de vue, le périmètre académique actuel des sciences de gestion, tel qu’il est défini par certaines instances, mérite d’être revisité. Non pour le rejeter, mais pour l’ouvrir. À l’interdisciplinarité, à la technologie, à l’éthique, à l’expérimentation. Aujourd’hui, nous avons besoin de cadres de pensée qui nous permettent d’agir dans la complexité, pas de grilles figées.
Qu’est-ce qui manque encore à l’ESR Enseignement supérieur et recherche pour s’emparer pleinement des enjeux contemporains ?
C’est une forme de lucidité. Celle qui oblige à revoir les fondations, pas seulement à repeindre les murs.
Des bouleversements systémiques qui exigent de repenser nos finalités »On parle souvent de transformation, mais on transforme rarement l’essentiel : les grilles de lecture, les postures académiques, les systèmes de reconnaissance. L’intelligence artificielle, la donnée, les transitions climatiques et sociales ne sont pas des thèmes à ajouter aux maquettes de formation. Ce sont des bouleversements systémiques qui exigent de repenser nos finalités, nos méthodes, nos modèles économiques, et notre rapport même au savoir.
Il manque aussi une véritable audace d’hybridation. Faire dialoguer un ingénieur et un philosophe, un designer et un codeur, un économiste et un poète : cela suppose de décloisonner les disciplines, mais aussi les statuts, les cultures, les egos.
À Aivancity, cela n’a pas été simple. Il y a eu des résistances, des incompréhensions. C’est un travail de culture, parfois un affrontement d’identités académiques.
Et surtout, il manque du temps long. Dans un monde qui accélère, l’ESR devrait être l’un des derniers espaces capables de ralentir. De penser. De douter. De rêver. Il est aujourd’hui trop souvent épuisé par la logique des indicateurs, des procédures, des classements, qui, parfois, ne mesurent rien d’essentiel.
Ce qu’il manque, en réalité, c’est une vision de l’éducation comme acte politique, poétique, profondément humain. Et cela, aucune réforme ne peut l’imposer.
Y a-t-il encore une marge de manœuvre pour réformer les grandes structures de l’intérieur ?
Il y a toujours une marge mais elle est mince. Et elle exige une énergie démesurée.
Les grandes structures sont souvent conçues pour durer, non pour évoluer. Elles avancent lentement, saturées d’habitudes, prises dans des équilibres complexes, soumises à des logiques de précaution. On peut y améliorer certains dispositifs, moderniser des pratiques, ouvrir quelques brèches. Mais dès qu’on s’attaque à l’essentiel — la finalité, la gouvernance, le rapport au savoir — les résistances deviennent systémiques.
C’est pour cela que j’ai fait un autre choix. Pour innover réellement, il faut parfois construire à côté. Et montrer que d’autres modèles sont possibles. Je l’ai vécu personnellement en 2019 : après avoir obtenu l’aval du conseil de surveillance d’EMLyon pour lancer un projet d’école dédiée à l’intelligence artificielle, le cap a finalement été écarté. Une décision qui traduisait moins un désaccord sur le fond qu’un écart de temporalité, de vision… ou simplement de courage collectif à franchir le pas.
Un lieu qui ne demande pas l’autorisation pour changer les choses »Avec Aivancity, nous avons cherché à créer cet espace. Un lieu qui ne demande pas l’autorisation pour changer les choses. Nous avons dû trouver d’autres leviers pour peser, comme la convention de coordination territoriale Paris Est avec les universités et les acteurs institutionnels et économiques du territoire. Cela nous permet d’exister dans le paysage international de l’enseignement supérieur avec plus de poids, tout en conservant la liberté d’expérimenter.
Sans cette liberté, nous n’aurions pas pu mettre en œuvre certaines politiques comme l’alternance responsable : prendre à notre charge le financement des étudiants sans contrat, parce que nous croyons en leur parcours. Dix étudiants en ont bénéficié la première année.
Qu’est-ce qui freine encore, selon vous, la culture académique française ?
Principalement la verticalité, la sacralisation des statuts et une certaine frilosité face à l’ouverture. La culture académique française valorise encore trop les titres plutôt que les projets, la théorie plutôt que l’usage, la conformité plutôt que l’expérimentation.
L’interdisciplinarité, la pédagogie ou la pratique de terrain restent insuffisamment reconnues. J’ai publié de nombreux articles scientifiques lus par quelques pairs. Aujourd’hui, je publie aussi des tribunes ou billets plus accessibles, largement diffusés, qui génèrent un impact réel. Pourquoi ces formats restent-ils marginaux dans nos critères de reconnaissance ?
Le monde académique reste aussi très hiérarchisé. Là où le savoir devrait circuler et se partager, il est encore souvent enfermé dans des silos.
Une nouvelle génération ose bouger les lignes »Toutefois les choses évoluent. Une nouvelle génération ose bouger les lignes. À Aivancity, nous recrutons des enseignants alignés avec notre vision. Nous avons doublé le nombre d’enseignants permanents après l’obtention du visa. Chaque euro disponible a été réinvesti dans l’école. C’était, et ça reste, un choix assumé : bâtir une institution avant de penser à soi.
Nous avons mis en place une clinique de l’IA, accompagné 100 entreprises, sensibilisé 10 000 professionnels. Ces actions, initialement hors des critères traditionnels, participent pourtant à une redéfinition de ce que peut être un établissement d’enseignement supérieur.
Peut-on concilier un modèle économique viable et un projet éducatif d’intérêt général ?
Oui, à condition de redéfinir ce que l’on entend par “viable”. Si la viabilité ne se limite pas à la rentabilité financière, mais inclut la capacité à durer sans se renier, à créer de la valeur humaine, sociale et collective, alors oui, un tel projet est possible.
C’est ce que nous tentons de faire avec Aivancity : refuser de choisir entre excellence et inclusion, technologie et humanité, innovation et sens.
Nous avons refusé l’entrée de fonds d’investissement, malgré les sollicitations nombreuses. Et nous nous sommes constitués en entreprise à mission, dès la création d’Aivancity, une première dans le paysage de l’enseignement supérieur en 2020.
Sa vision de l’Afrique : « L’enjeu n’est plus d’exporter des modèles »
Comment voyez-vous la place de l’ESR français dans le monde, notamment en Afrique et au Maroc ?
L’enseignement supérieur français reste une référence »J’ai vécu de près l’exportation du savoir académique français au Maroc, à travers l’expérience EMLyon. Ce que j’ai constaté, c’est que la compétition ne se joue plus sur la seule excellence académique. Il ne suffit pas de venir avec un modèle : les approches descendantes, ponctuelles, ne fonctionnent pas. Ce qui fait la différence, c’est la capacité à coopérer, à construire ensemble, dans la durée.
L’enseignement supérieur français reste une référence dans de nombreux domaines : solidité des savoirs, qualité des chercheurs, rigueur des formations. Il a néanmoins parfois du mal à se projeter dans une dynamique internationale véritablement partenariale. Trop souvent, il regarde encore le monde depuis son centre, au lieu de s’y insérer avec humilité.
Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus d’exporter des modèles, mais de co-construire des solutions. En Afrique et au Maroc en particulier, le lien avec l’ESR français est fort, mais parfois déséquilibré.
La France a une carte à jouer, à condition de passer d’une logique de transmission à une logique d’écoute. L’Afrique n’attend pas de solutions : elle est déjà en train de les inventer.
Je crois que l’avenir de l’enseignement supérieur mondial ne viendra pas uniquement des grandes capitales académiques, mais aussi de Casablanca, de Dakar, de Kigali, de Bangalore, de Nairobi. Des lieux où l’éducation n’est pas un luxe, mais une nécessité.
Quel rôle jouez-vous au Maroc et comment organisez-vous votre travail ?
Je constate une forte concurrence. De plus en plus d’étudiants marocains choisissent d’autres destinations, comme l’Asie ou l’Amérique du Nord. Dans ce contexte, je suis heureux de l’impact que nous avons avec le groupe Edvantis (ISGA) dont je suis président du CA Conseil d’administration et actionnaire avec AfricInvest : nous n’étions dans aucun classement, et aujourd’hui nous figurons parmi les meilleures écoles.
Nous sommes passés de 1 200 à 2 400 étudiants, avec une hybridation inédite : ingénierie, management, design, communication dans un même groupe.
Je passe trois semaines par mois en France, et une semaine au Maroc. C’est ma manière de contribuer, de rendre à mon continent ce qu’il m’a donné.
Tawhid Chtioui
Fondateur et DG @ CCCLX
Fondateur et DG @ aivancity school of AI & Data for Business & Society
Distinctions et prix
Chevalier (2016) puis Officier (2022) de l’ordre des Palmes Académiques ;
Top 100 Leaders in Education Award, du Global Forum on Education & Learning ;
The Name in science & Education Award, du Socrates Committee Oxford Debate University of the Future ;
Top 10 Most Inspiring People in Education, 2022;
Sélectionné parmi les 25 personnalités mondiales les plus influentes dans le domaine de l’IA et des données par Keyrus (Janvier 2025).
Consulter la fiche dans l‘annuaire
Parcours
Fondateur et DG
Fondateur et DG
Directeur général
Président du directoire
Directeur Général Afrique
Directeur National ISEG Business & Finance School
Directeur Exécutif
Directeur délégué
Maitre de conférences associé
Professeur et directeur de Mastère Spécialisé
Allocataire-moniteur puis Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Établissement & diplôme
Executive certificate - Leadership Development Program in Higher Education
Doctorat en sciences de gestion
DEA, décision, contrôle
Fiche n° 3266, créée le 01/04/2014 à 09:11 - MàJ le 27/08/2025 à 12:08
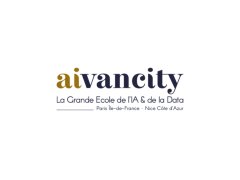
aivancity school of AI & Data for Business & Society
Catégorie : Écoles spécialisées
Entité(s) affiliée(s) :
CCCLX
Adresse du siège
151 boulevard Maxime Gorki94800 Villejuif France
Consulter la fiche dans l‘annuaire
Fiche n° 10144, créée le 11/09/2020 à 04:32 - MàJ le 20/11/2025 à 11:44



 Président Fondateur @ Trajecthoard
Président Fondateur @ Trajecthoard