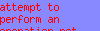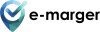Thomas Pardoen (UCL) : « La France ne fait pas confiance à ses chercheurs »
« La France ne fait pas confiance à ses chercheurs. C’est sans doute l’un des pires pays que je connaisse de ce point de vue ! Je ne sais pas comment la France est arrivée à un tel niveau de contrôle et de manque de confiance par rapport à la recherche », déclare Thomas Pardoen, directeur de l’Institut de mécanique, matériaux et génie civil de l’Université catholique de Louvain et lauréat du prix Alcan de l’Académie française en 2011, à News Tank, le 13/01/2017.
Il analyse pour News Tank les différences France/Belgique/États-Unis dans le domaine des sciences de l’ingénieur : « Le niveau en France reste très bon parce qu’il y a une incroyable motivation de certains collègues qui sont des puristes, qui restent détachés des questions de salaires, de qualité de vie au travail… Aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus attirés par les conditions de travail correctes. »
Thomas Pardoen plaide pour « plus de subsidiarité : engager les bonnes personnes, leur faire confiance, ramener les moyens financiers à l’échelle locale et mettre en place des procédures solides, quitte à engager un peu moins de monde ».
Le séminaire Think Technology, organisé dans le cadre de Think Education le 07/02/2017 à Paris-Dauphine, doit dresser des pistes pour la formation et la recherche technologiques en France. En amont et afin de préparer les débats, News Tank réalise une série d’entretiens sur ces thématiques.
Thomas Pardoen répond à News Tank
Quel a été votre parcours entre la Belgique, la France et les États-Unis ?
J’ai réalisé ma thèse à l’Université catholique de Louvain (terminée en 1998) où j’ai également obtenu une maitrise de philosophie. J’ai ensuite passé deux ans à Harvard pour mener des recherches dans le domaine de la mécanique et des matériaux.
Puis, j’ai obtenu un poste de professeur dans mon université d’origine où je suis donc retourné en 2000. Cela se fait beaucoup en Belgique et en France, on aime revenir chez soi, c’est sans doute une différence importante par rapport à d’autres pays dans le monde.
Et aujourd’hui, que faites-vous ?
Je dirige l’Institut de mécanique, matériaux et génie civil de l’UCL qui a la taille d’un gros laboratoire français, et au sein duquel j’encadre personnellement une vingtaine de chercheurs. En Belgique, dans le domaine des sciences de l’ingénieur, nous avons parfois de grosses équipes. Un permanent peut facilement encadrer 10 à 12 doctorants et post-doctorants, c’est un système assez pyramidal.
Je suis également président du conseil scientifique du centre nucléaire belge, qui est l’équivalent du CEA en France, à une échelle nettement plus petite.
Les sciences de l’ingénieur fonctionnent-elles de la même manière d’un pays à l’autre ou observez-vous des différences ?
C’est très différent d’un pays à l’autre. Je suis frappé par le rôle et l’importance des réseaux cachés, qui sont terriblement présents en France et, parfois, en Belgique.
Des connivences positives entre laboratoires et entreprises »J’observe qu’en France des ingénieurs passent par des laboratoires de recherche, démarrent des carrières dans de grandes entreprises et continuent de garder un lien au niveau de la recherche avec leur institution d’origine. Ils ont alors une tendance naturelle à collaborer avec leurs anciens patrons de thèse ou leur ancien laboratoire. Cela créé des connivences positives entre laboratoires et entreprises en jouant sur l’aspect humain et sur les confiances réciproques.
Dans ce contexte, le mode de travail entre l’entreprise et l’université n’est pas un rapport de donneur d’ordres. Et c’est tant mieux car la pure sous-traitance ne fonctionne pas en matière de recherche.
Pour les personnes qui ne maîtrisent pas ces réseaux, il est difficile de comprendre comment certains collègues font pour obtenir des financements et pas d’autres.
Quelle perception avez-vous de la recherche en France dans votre domaine ?
Le plus frappant est la difficulté très significative qu’ont mes collègues en France pour déployer leur recherche avec suffisamment d’amplitude. Les taux de succès ANR sont catastrophiquement bas. On ne peut pas maintenir leur enthousiasme avec des taux de réussite de 10 %. S’ils ont réussi les concours c’est qu’on a considéré qu’ils avaient le niveau. Vouloir les sélectionner aussi durement une nouvelle fois, c’est un gâchis !
Soit il faut engager moins de permanents, soit on considère que les bonnes personnes ont été recrutées et il faut leur donner les moyens de vivre.
On ne fait pas des développements technologiques qui auront un impact avec deux personnes »Même en Belgique, où les conditions de financement sont meilleures qu’en France, je vois de jeunes chercheurs qui au bout de trois ou quatre ans ont envie de baisser les bras. Il faut les soutenir car une recherche en ingénierie qui a du sens doit avoir une amplitude de taille critique. On ne fait pas des développements technologiques qui auront un impact avec deux personnes. Si on veut résoudre des problèmes à cinq ou dix ans, il faut une masse critique de chercheurs et les équipements nécessaires.
Dans mon domaine, on a besoin de moyens pour avancer et on peut stagner pendant 10 ans si l’on n’a pas un minimum d’argent « libre » en plus des appels à projets classiques. On engage parfois des chercheurs en oubliant le moyen et le long terme.
La situation est-elle meilleure aux États-Unis où vous avez passé deux ans ?
Aux États-Unis il y a de tout : c’est très différent d’être au MIT Massachusetts Institute of Technology ou dans une petite université de province. J’ai connu un lieu, Harvard, où les problèmes de finances n’existaient pas. Quand l’argent ne venait pas du public, il venait de fondations privées. Le problème là-bas pour un chercheur est de trouver du temps pour aller au bout de ses idées.
Aux Etats-Unis, un jeune académique négocie un package lors de son recrutement »Aux États-Unis mais aussi plus près de nous en Suisse, j’observe que le financement de la recherche est plus stable, plus pérenne. Quand on a sélectionné quelqu’un, on lui donne une partie des moyens de façon récurrente et institutionnalisée, on arrête de mettre les gens tout le temps en compétition.
D’ailleurs aux États-Unis, un jeune académique négocie un package lors de son recrutement. Il s’assure, par exemple, de pouvoir pendant dix ans démarrer un nombre donné de thèses et de pouvoir financer des équipements. Cela lui garantit un « matelas », alors qu’en France et en Belgique cela peut s’écrouler du jour au lendemain.
Les fonds provenant du privé sont-ils la solution ?
Dans les sciences de l’ingénieur, ceux qui s’en sortent vont en effet chercher des fonds privés. Mais dans ce cas ils ne préparent pas la recherche pour l’horizon à 20 ans et plus, qui pourrait déboucher sur des recherches majeures.
Dans ce contexte, comment jugez-vous le niveau de la recherche en France ?
Le niveau en France reste très bon parce qu’il y a une incroyable motivation de certains collègues qui sont des puristes, qui restent détachés des questions de salaires, de qualité de vie au travail… Aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus attirés par les conditions de travail correctes.
Ce qui fonctionne bien en France c’est les équipes extrêmement soudées où les permanents se regroupent à cinq ou dix et se font confiance. Ils vont chercher des labex, des equipex, de façon solidaire et permettent ainsi aux projets de l’ensemble du groupe de continuer.
En outre, le niveau de formation en France dans les écoles et les universités est très bon.
La dispersion des structures qui forment aux sciences de l’ingénieur en France et leur petite taille relative sont-elles des obstacles selon vous ?
La bonne recherche vient des leaders, des meneurs de recherche »C’est un leurre de penser que faire plus gros amène plus de qualité. La bonne recherche vient des leaders, des meneurs de recherche, qui osent, qui sont charismatiques. Il faut que les structures comprennent cela, détectent ces personnes et les utilisent comme poissons-pilotes.
Avoir une certaine taille permet certainement d’avoir des moyens et des politiques plus ambitieuses, mais la recherche reste une question de personnes. Si ça marche si bien à l’EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne , c’est qu’ils font d’abord confiance à leurs chercheurs.
Pour moi, la diversité institutionnelle est secondaire. L’enjeu est d’engager des personnes de qualité en adoptant les procédures les plus riches possible. Il faut des commissions avec des personnes extérieures, prendre le temps de rencontrer les candidats, et renoncer si on n’a pas trouvé le profil que l’on recherche. C’est cela qui va dicter la qualité.
La richesse institutionnelle nuit sans doute à la lisibilité, mais cela ne change rien par rapport à des collaborations internationales en recherche car on travaille d’abord avec des personnes, plus qu’avec des structures.
Vous semblez critique sur la condition faite aux chercheurs en France…
Le système français est devenu caricatural »La France ne fait pas confiance à ses chercheurs. C’est sans doute l’un des pires pays que je connaisse de ce point de vue ! Je suis gêné quand mes collègues nous invitent de l’étranger et qu’ils ont un mal fou à nous rembourser nos billets. Il ne faut pas dilapider l’argent, bien sûr, mais de temps en temps il faut donner un peu de liberté, y compris financière !
Le système français est devenu caricatural. J’entends des collègues qui ne demandent plus les remboursements et qui y vont de leur poche tellement c’est long et compliqué.
Je ne sais pas comment la France est arrivée à un tel niveau de contrôle et de manque de confiance par rapport à la recherche. En Allemagne, aux États-Unis et dans les pays du Nord, je n’entends pas cela.
Je plaide pour plus de subsidiarité : engager les bonnes personnes, leur faire confiance, ramener les moyens financiers à l’échelle locale et mettre en place des procédures solides, quitte à engager un peu moins de monde. Et bien sûr travailler sur la qualité de vie au jour le jour.
L’interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont-elles assez développées en sciences de l’ingénieur ?
Nous sommes dans une réflexion à l’École polytechnique de Louvain de l’UCL pour renforcer encore davantage les sciences humaines à tous les niveaux du cursus. Nous avons ainsi développé un programme « ingénieuxsud » où nos étudiants partent en coopération.
Plus de 100 étudiants vont ainsi chaque année en Afrique, sur le terrain, avec de vrais projets technologiques à mener en interaction aussi avec une université. Ils sont, pour cela, formés aux différents aspects de la coopération (économie, éthique, environnemental).
Créer des structures qui permettent le brassage »Plus largement, il faut créer des structures qui permettent le brassage, car à part quelques personnes hors normes, les gens vont garder plus de plaisir à travailler sur leur sujet et à persévérer incrémentalement dans leur sujet. Il faut donc créer les conditions pour que les ingénieurs rencontrent les médecins, les agronomes, les SHS.
Cela suppose des mécanismes, des « carottes », pour favoriser l’interdisciplinaire. Cela passe par des rencontres, des modes de financement incitatifs, pour que les personnes se croisent.
Je crois aussi beaucoup à la nécessité de repenser les locaux : les chercheurs ont besoin d’espaces plus grands, avec des formes de lounge, sans luxe, mais pour ouvrir des discussions au-delà des domaines disciplinaires les plus proches.
Attention aussi à ne pas constituer des labos énormes où il devient difficile de brasser les profils. A Harvard sur les 20 personnes de la division of engineering qui partageaient le même couloir, il y avait des gens d’horizons très divers : solides, fluides, maths, physique, biomécanique. Tous les jours, ils parlaient ensemble. Cette division n’était pas plus grande qu’un gros laboratoire français mais rassemblait des prix Nobel.
On peut s’inspirer du monde de l’entreprise : des sociétés se sont montrées très créatives pour favoriser l’innovation.
L’université vous semble avoir du mal à adopter ces nouvelles pratiques ?
C’est le lieu numéro 1 où l’on devrait exceller dans la créativité mais on n’y arrive pas, ou difficilement.
Je le vois dans mon université où je me bats pour créer des lieux de rencontre de type lounge « créatif », de relaxation. Cela se fait dans beaucoup d’entreprises mais ici on me rit presque au nez.
Alors que les universités devraient expérimenter la gestion participative et de nouvelles formes d’organisation spatiale, elles fonctionnent encore comme il y a 100 ans avec de petites salles café, de petits bureaux…
On voit, par exemple, que les taux de fréquentation des bibliothèques sont les plus hauts. Mais on est en retard par rapport à cette information : on n’utilise pas le fait que nos étudiants adorent être ensemble, connectés… Avec ce constat il y a énormément à faire pour les stimuler et les motiver mais on ne l’utilise pas bien.
Y-a-t-il une concurrence dans le recrutement des meilleurs chercheurs en sciences de l’ingénierie ?
C’est variable et encore assez faible. En France, Belgique, et Espagne, la mobilité reste faible. En revanche, elle est forte en Suisse et ses deux écoles polytechniques prestigieuses, et aux États-Unis.
Cela va évoluer, il faut s’y préparer, notamment en raison de l’impact des financements ERC
 European Research Council
, qui créent un système de « starification ». L’ERC est vraiment très bien, je ne le remets surtout pas en cause, mais on crée des stars et certaines universités l’ont compris.
European Research Council
, qui créent un système de « starification ». L’ERC est vraiment très bien, je ne le remets surtout pas en cause, mais on crée des stars et certaines universités l’ont compris.
Depuis deux ou trois ans, on voit des démarches comme celles de clubs de foot car le chercheur lauréat d’une ERC peut partir avec ses moyens. Des universités du top 10 européens utilisent ce levier pour se renforcer.
Je vois deux évolutions possibles :
- soit l’ERC change un peu ses règles pour éviter ou gommer certains side-effects néfastes ;
- soit on doit se préparer à vivre avec cette donne et créer dans les établissements des modes de fonctionnement tels que l’on ne crée pas des castes de stars et de frustrés. Car des gens excellents vont faire leur carrière sans ERC et on ne doit pas les pénaliser, leur casser le moral. Ce serait pervers. Mais on doit en même temps tout faire pour promouvoir l’excellence en recherche dans la ligne de l’ERC.
La réponse est certainement dans une organisation collective de la recherche.