Bachelors : « La digue et le canal » (Jean-Michel Jolion)
« La poursuite d’études est actuellement une constante culturelle qui est peu remise en cause. L’insertion professionnelle est encore trop souvent présentée négativement comme concernant les “moins bons” et ceci dès le plus jeune âge. Il est donc difficile de s’y opposer », écrit Jean-Michel Jolion

dans une première chronique pour News Tank, le 26/02/2025. Aujourd’hui retraité, l’ancien professeur à l’Insa
Institut national des sciences appliquées
de Lyon et ancien conseiller ministériel, a terminé sa carrière en 2024 par une mission pour la Dgesip
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
autour des besoins de formation d’ingénieurs en France.
Il revient dans cette chronique sur le fort développement des bachelors. Initialement créés pour répondre aux besoins économiques et assurer une insertion professionnelle rapide, ces programmes évoluent vers un statut de diplôme intermédiaire.
L’insertion professionnelle après un bachelor reste un défi, avec un nombre croissant d’étudiants poursuivant des études plus longues. Il constate, notamment s’agissant des nouveaux BUT
Bachelor universitaire de technologie
qui ont remplacé les DUT
Diplôme universitaire de technologie
, qu’il « existe toujours un frein culturel face à l’insertion professionnelle immédiate. La poursuite d’études est toujours vue comme un critère de qualité de la filière ».
Il regrette également que « l’ensemble de l’appareil de formation organise cette poursuite d’études (des BTS
Brevet de technicien supérieur
vers les LP
Licence professionnelle
, des BUT vers les grandes écoles…) plutôt que d’inciter les jeunes à s’insérer ».
Pour améliorer l’insertion professionnelle des bachelors, il juge essentiel de renforcer la confiance dans la formation tout au long de la vie et d’établir un droit à l’accompagnement pour la montée en compétence.
Un canal qui s’inverse…
À l’heure où Parcoursup occupe l’attention de très nombreux jeunes et leurs familles, jetons un regard sur un des secteurs en fort développement, les bachelors. Aujourd’hui on en dénombre plus de 1 000 accessibles via Parcoursup.
Derrière ce vocable se cache bien sûr une grande disparité de formations mais un point commun indéniable : une genèse issue du besoin économique, la promesse de l’insertion professionnelle immédiate et une évolution lente mais inexorable vers le statut de diplôme intermédiaire.
À leur création en 1966, les IUT Institut universitaire de technologie , pensés comme « une digue et un canal » selon l’expression de Guy Brucy [1], devaient permettre de diriger des étudiants vers des emplois de cadres intermédiaires réclamés par les employeurs (effet canal) mais ils étaient aussi un moyen d’absorber une augmentation des effectifs étudiants en les détournant des formations longues classiques (effet digue).
Dans le secteur commerce/gestion/management, on a aussi vu se développer l’offre post-bac (notamment au début des années 2000) conduisant au bachelor, toujours pour le même effet « canal » (le besoin des entreprises) mais avec un effet « digue » renversé rapidement en deuxième effet « canal », c’est-à-dire une formation conçue pour permettre l’accès des meilleurs au cursus longs à bac + 5 tout en maintenant une bonne insertion professionnelle immédiate. Cette offre est quasiment exclusivement portée par des écoles privées.
Une insertion professionnelle après le bachelor difficile à atteindre
Depuis maintenant trois ans, le cursus des IUT a été refondé en considérant que ce diplôme n’avait plus aucun effet canal avec une poursuite d’études qui dépassait les 90 % notamment au sein des licences professionnelles. Le BUT Bachelor universitaire de technologie , bachelor universitaire de technologie (qui formellement est une licence professionnelle), a donc un objectif officiel de recréer un effet canal significatif avec une insertion professionnelle immédiate au moins égale à 50 %. Il sera à ce titre intéressant d’observer le devenir de la première promotion diplômée du BUT.
Toujours sur une motivation officielle liée à l’emploi sur les techniciens supérieurs et les cadres intermédiaires au sein des entreprises, on a vu se créer depuis quelques années de nombreux bachelors (une centaine accessible via Parcoursup) dans le domaine « sciences et ingénierie » (très majoritairement portés par des écoles privées). La CTI Commission des titres d’ingénieur , à la demande du MESR Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche , évalue les dossiers de bachelor en sciences et ingénierie qui souhaitent conférer le grade de licence. Il y a donc un contrôle partiel sur l’offre.
Comme pour les BUT, l’insertion professionnelle immédiate reste un objectif difficile à atteindre, et l’effet digue inversé (faire poursuivre les meilleurs) devient très vite la motivation principale de la formation. Cette poursuite d’études est aussi une des questions principales des familles sur les salons.
De la même manière, les multiples passerelles créées pour les titulaires du BTS Brevet de technicien supérieur pour intégrer des bacs + 3… montre que ce deuxième effet « canal » (la poursuite d’études) devient plus important que celui pensé initialement (l’insertion professionnelle), alors que le besoin des entreprises en cadres intermédiaires reste d’actualité.
Pour certaines écoles, le bachelor est un « produit » qui est intéressant pour l’apprentissage, pour capter des jeunes post-bac, et faire de l’ouverture sociale. Le dispositif est même revendiqué pour permettre plus d’ouverture sociale dans le cycle ingénieur par leur poursuite d’études, même si la CTI souhaite faire du taux de poursuite d’études un critère négatif dans l’évaluation.
On se rappellera à ce titre qu’il en était de même à l’origine des licences professionnelles. Il était annoncé un non renouvellement de l’habilitation du ministère au-delà de 15 % de poursuite d’études. Cela n’a été mis en œuvre qu’une ou deux fois. Au fil des années, ce critère n’a plus été utilisé et beaucoup de licences professionnelles ont des taux de poursuite largement supérieurs à 50 %.
Ce qu’attendent les entreprises
Du côté des entreprises, ces positions de cadres intermédiaires, qui devraient être la cible principale de ces bachelors, sont clairement identifiées et par exemple différenciées des ingénieurs sur la capacité d’abstraction en lien avec l’innovation.
Les entreprises n’attendent pas de valeur ajoutée sur l’innovation de la part des techniciens supérieurs et seulement des cadres intermédiaires quand ils ont eu un parcours général en amont de leurs études supérieures (on reste sur des modèles très déterministes où le baccalauréat d’origine influe l’appréciation post-diplôme du supérieur).
Encore peu réglementé (en dehors du BUT), le bachelor reste un lieu d’expérimentation et d’investissement sur des nouveaux débouchés.
Connecté aux besoins des entreprises, le plus souvent sur un bassin local, ces formations restent néanmoins fragiles, d’une part à cause de la baisse démographique à venir et des droits d’inscription qui peuvent être élevés, et d’autre part par l’appétence des diplômés à poursuivre qui conduira les entreprises à s’en détacher (pourquoi investir sur une formation en apprentissage de plusieurs années si cela ne conduit pas à un vivier de recrutements en sortie ?).
Et une digue bien fragile…
La problématique de la poursuite d’études est une spécificité française qui pousse tous les jeunes vers les études longues. La dernière enquête de l’Observatoire de la Vie Étudiante (OVE Observatoire national de la vie étudiante , Repères 2023) montre que plus de la moitié des étudiants de premier cycle envisage de poursuivre leurs études.
Seuls 26 % des étudiants de STS Sections de technicien supérieur envisagent une insertion professionnelle à la fin de leur cursus ; 33 % envisagent une poursuite à bac + 3 et 41 % au-delà.
Même au sein des écoles d’ingénieurs, 24 % des étudiants envisagent de poursuivre leurs études au-delà du Bac + 5 (avec cependant une baisse notable puisque ce taux était de 34 % en 2016 et 38 % en 2020).
Cette appétence à la poursuite d’études existe dès l’entrée dans le supérieur quelle que soit l’origine sociale des étudiants. Ainsi, l’enquête de l’OVE montre que parmi les primo entrants post bac dans l’enseignement supérieur, 65 % des enfants d’ouvriers se projettent sur des études longues (bac + 4 ou plus) et ce taux passe à 90 % pour les enfants de cadres. Le phénomène est donc bien présent et caractérisé par le contexte familial et social.
Sur les 125 000 jeunes formés chaque année aux métiers de l’industrie (jusqu’à bac + 2), on estime que 50 % ne s’insèrent pas dans ces métiers : un tiers ne s’insèrent pas (principalement en poursuite d’études) et au moins 10 % s’insèrent, mais dans d’autres métiers (très fluctuant selon les métiers, [2]). On ne peut satisfaire aux besoins des entreprises avec un tel taux et l’attractivité de ces métiers rend difficile l’accroissement des viviers pour compenser cette « évaporation ».
Au niveau international, la France est atypique sur le niveau de diplôme le plus élevé atteint au sein de la population des 25-34 ans (cf supra) en étant 8 points au-delà de la moyenne de l’OCDE
![]() Organisation de coopération et de développement économiques
sur la part de cette population titulaire d’un diplôme de niveau master.
Organisation de coopération et de développement économiques
sur la part de cette population titulaire d’un diplôme de niveau master.
Cette course au diplôme est aussi caractérisée par une volonté de le faire uniquement par la voie de la formation initiale : « Entrer le plus vite dans l’enseignement supérieur, aller le plus loin possible et ne plus jamais y revenir ». Et tout cela induit naturellement que la France a les étudiants les plus jeunes d’Europe.
Un frein culturel face à l’insertion professionnelle immédiate
Du côté offre de formation de techniciens, au sein des IUT, il existe toujours un frein culturel face à l’insertion professionnelle immédiate. La poursuite d’études est toujours vue comme un critère de qualité de la filière.
Clairement, cette culture DUT Diplôme universitaire de technologie est en train de passer sur le BUT. Si on dépasse très vite le 50 % de poursuite d’études (notamment dans le secteur de la production), le milieu des entreprises va se détourner de cette formation et son contenu va intégrer ce débouché majoritaire et le diplôme sera de moins en moins connecté aux besoins industriels.
On peut également regretter que l’ensemble de l’appareil de formation organise cette poursuite d’études (des BTS vers les LP Licence professionnelle , des BUT vers les grandes écoles…) plutôt que d’inciter les jeunes à s’insérer.
Une prédominance du diplôme sur la compétence
Sans pour autant justifier cette démarche, on en trouve une partie de la motivation des jeunes et de leurs familles dans le constat que la France se caractérise aussi par une prédominance du diplôme sur la compétence.
Très souvent, si vous cherchez un emploi à 40 ans, on commencera par vous demander quel est votre diplôme plutôt que vos compétences. De même, l’absence de réelle reconnaissance (statut et salaire) par les entreprises pour les métiers de cadres intermédiaires conduit des jeunes à préférer continuer au-delà du bac + 2/+3. On l’a vu avec les DUT qui continuaient en licence professionnelle sans avoir de réel gain salarial ce qui les incitaient à poursuivre leurs études jusqu’au bac + 5.
La poursuite d’études est actuellement une constante culturelle qui est peu remise en cause. L’insertion professionnelle est encore trop souvent présentée négativement comme concernant les « moins bons » et ceci dès le plus jeune âge. Il est donc difficile de s’y opposer.
De plus, le besoin des entreprises en ingénieurs et cadres conduit les formations intermédiaires à instrumentaliser cette poursuite d’études, accroissant en cela la tension sur le marché des techniciens supérieurs et cadres intermédiaires.
L’absence d’une réelle formation tout au long de la vie
Dernier facteur qui pousse à la poursuite d’études : l’absence d’une réelle formation tout au long de la vie qui puisse permettre de croire, lorsque l’on a un bachelor, que l’on va réellement pouvoir obtenir un diplôme d’ingénieur plus tard par la VAE Validation des acquis de l’expérience . Les chiffres sur ce secteur sont affolants : de l’ordre de 47 000 diplômés ingénieurs par la formation initiale chaque année, de l’ordre de 2 000 par la formation continue et, les bonnes années, 150 par la VAE (soit 0,3 %).
Nous ne pourrons donc développer l’insertion professionnelle des cursus comme le bachelor que quand nous aurons redonné confiance dans la formation tout au long de la vie, avec un vrai droit à l’accompagnement sur la montée en compétence et sa valorisation diplômante au niveau master.
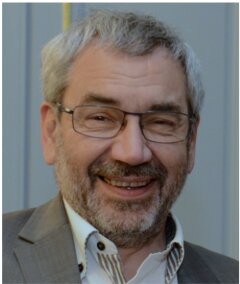
Parcours
Membre
Délégué ministériel à la vie étudiante
Professeur dess universités
Coordinateur
Conseiller en charge de la formation, des politiques de site et des relations entre la science et la société au cabinet de la ministre de l’Esri
Conseiller en charge des politiques de site et des relations entre la science et la société auprès de Frédérique Vidal
DRRT Auvergne Rhône-Alpes
Conseiller en charge des formations du supérieur et de l’orientation
Chef du service de la stratégie de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle à la DGESIP
Chef du projet Programme Investissements d’Avenir
Responsable du service Développement et aménagement des Campus
Président du comité de suivi master
Délégué général
Conseiller scientifique auprès du vice-président
Directeur Adjoint de la Recherche
Maître de conférences
Établissement & diplôme
Ingénieur et docteur en informatique
Fiche n° 3489, créée le 22/04/2014 à 12:00 - MàJ le 20/06/2025 à 17:33
[1] Guy Brucy (2016), « La naissance du baccalauréat de technicien », in CPC Info, n° 58, « Le point sur… Les 30 ans du Bac Pro », pp. 9-18.
[2] Basset G. et O. Lluansi, 2024, sur la base de travaux du Cereq, de l’Insee et de France stratégie.


