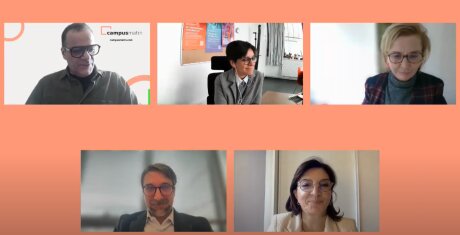Coopérations établissements-entreprises : « Vers des projets de plus long-terme » (Sandrine Belloc)
« Les stages sont, de très loin, le mode de coopération le plus utilisé dans le monde entre les établissements et les entreprises. Mais la demande des professionnels va au-delà : ils souhaitent aller vers des projets de plus long terme, qui intègrent davantage les équipes entre elles », déclare Sandrine Belloc
 Co-fondatrice et directrice générale @ Emerging
Co-fondatrice et directrice générale @ Emerging
, directrice générale du cabinet Emerging, le 23/01/2025, à l’occasion d’un webinaire organisé par News Tank, Campus Matin et Emerging.
Emerging produit depuis 2010 le Geurs
Global employability ranking and survey
(Global Employability University Ranking and Survey), publié par Times Higher Education. Cette année, Emerging a mis en place un panel français spécifique pour « obtenir des enseignements ciblés sur le comportement des recruteurs français », pour sa collaboration avec News Tank.
Ce webinaire, intitulé « Coopération établissements-entreprises : freins et bonnes pratiques », intervient avant le Think éducation & recherche 2025. Le 06/02/2024 seront dévoilés le classement et les prix News Tank/Emerging de la « Coopération établissements-entreprises ».
D’après l’étude d’Emerging, dont Sandrine Belloc dévoile quelques enseignements lors de ce webinaire, « les acteurs français ont bien compris qu’une collaboration efficace nécessitait d’aller plus loin que le simple stage ».
Marie-Christine Bert, directrice des partenariats entreprises de l’École nationale des ponts et chaussées (IP Paris), Angela Vasanelli, professeure à l’Université Paris Cité et directrice de l’école d’ingénieurs Denis Diderot, et Federico Pigni
 Doyen du corps professoral @ Grenoble École de Management (GEM) • Visiting professor @ Università di Pavia • Professor @ Grenoble École de Management (GEM) • Senior consutlant @ Cutter Consortium
Doyen du corps professoral @ Grenoble École de Management (GEM) • Visiting professor @ Università di Pavia • Professor @ Grenoble École de Management (GEM) • Senior consutlant @ Cutter Consortium
, doyen de la faculté de GEM
Grenoble Ecole de Management
, développent des exemples de pratiques allant dans ce sens dans leurs établissements.
« La demande, c’est du dialogue » (S. Belloc)
D’après Sandrine Belloc, « dans les débats qui agitent l’enseignement supérieur, l’interdisciplinarité ou la transdisciplinarité seraient des moyens pour fabriquer ces compétences, ou alors pour les consolider auprès des jeunes. Les employeurs disent : “Je ne sais pas évaluer ça, donc il faudrait que je puisse savoir ce que vous avez mis derrière, ce que vous avez fait pour créer ces compétences, etc.'
La demande à travers tout cela, c’est du dialogue. C’est dire : 'Attendez-nous, dialoguez avec nous, faisons ensemble. Ne vous lancez pas dans des projets tout seuls.” »
Les priorités de coopération selon les pays
Si l’importance de la coopération s’accroît dans tous les pays, les raisons en sont différentes selon les zones, développe Sandrine Belloc :
- « la Chine et les États-Unis cherchent avant tout à recruter les meilleurs talents : c’est leur priorité numéro un ;
- Pour la France, c’est une nouveauté, l’objectif principal est plutôt de collaborer pour créer des programmes de formation continue. Le recrutement des meilleurs talents arrive en deuxième position, mais de peu ;
- Ce qui est intéressant, c’est la position de l’Allemagne. C’est un pays où la coopération entre établissements d’enseignement supérieur et industrie est une tradition inscrite dans le système même. Pourtant, le recrutement des meilleurs talents n’arrive qu’en sixième position. Leur priorité est d’établir des centres et des laboratoires conjoints avec l’industrie, une pratique déjà en place qu’ils souhaitent maintenir et consolider ;
- Singapour, qui est un pays très innovant, met en priorité la coopération entre entreprises et universités pour injecter de l’innovation dans l’économie.
- Pour le Brésil, c’est la même chose. »
Des évolutions notables en France
En France, « des évolutions notables ont eu lieu » sur les modalités de la coopération, observe Sandrine Belloc :
- « en 2019, la relation entre les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur était largement dominée par les stages. Mais aujourd’hui, le nombre de projets pratiques avec les professionnels a quasiment doublé, devenant ainsi la principale modalité de collaboration ;
- le stage reste un élément clé, toujours à des niveaux très élevés, mais les entreprises françaises ont pris conscience de l’intérêt d’autres formes d’engagement;
- les événements RH Ressources humaines sur les campus ont également légèrement augmenté ;
- les projets de coopération en recherche, innovation, comités éducatifs et incubateurs ont connu une hausse de près de 30 % ».
Penser la coopération au niveau de la gouvernance
« Nous sommes souvent confrontés à des situations problématiques où une même personne en entreprise est approchée par deux interlocuteurs différents de notre organisation, sans coordination », témoigne Marie-Christine Bert
 Directrice des relations internationales et des partenariats entreprises @ ENPC (École nationale des ponts et chaussées)
Directrice des relations internationales et des partenariats entreprises @ ENPC (École nationale des ponts et chaussées)
.
D’après la directrice des partenariats entreprises de l’École nationale des ponts et chaussées, « il faut structurer la relation, donner une vision claire, favoriser une compréhension partagée et acculturer nos propres équipes à la relation entreprise. C’est avant tout une question de gouvernance ».
Elle donne l’exemple d’un partenariat de l’école avec l’ensemble du groupe Vinci, incluant Vinci Énergies, Vinci Construction, Vinci Concessions, ce qui pose des enjeux de gouvernance.
« Nous avons 150 actions sur l’année, dont 43 actions concrètes, et cela ne s’est pas fait tout seul. Il faut un cadre, du suivi, du rythme », d’après elle.
Sur la difficulté de faire travailler les équipes des établissements avec celles des entreprises, Federico Pigni ajoute : « On se retrouve avec, d’un côté, un vaste portfolio d’opportunités pour les entreprises afin de collaborer avec les écoles et universités, et de l’autre, plusieurs parties prenantes, chacune cherchant à capter des ressources, des financements ou des infrastructures en fonction de son propre intérêt. »
Des exemples d’organisation en interne
Marie-Christine Bert décrit l’organisation dédiée à la coopération des entreprises à l’École nationale des ponts et chaussées :
- « La relation école-entreprise est directement rattachée à l’enseignement, afin d’être au plus proche des programmes et des besoins académiques.
- La relation entreprise-recherche dépend de la direction de la recherche, ce qui permet une interaction plus efficace avec les laboratoires et les projets scientifiques.
- La relation entreprise pour la formation continue et l’implication des entreprises dans les programmes sont intégrées à la formation continue. »
Pour l’école d’ingénieurs Denis Diderot, Angela Vasanelli déclare : « Nous sommes une petite école, avec environ 280 étudiants, et notre cellule de relation entreprise est encore en construction ».
Elle détaille : « Pour l’instant, nous avons une seule personne en charge du développement des relations entreprises, et qui, en ce moment même, met en place cette cellule dédiée. Notre idée a été d’associer cette cellule à plusieurs autres axes stratégiques :
- Les relations avec les alumni, car leur rôle est crucial dans le développement de partenariats.
- La coordination des unités d’enseignement, notamment celles qui sont en lien avec la professionnalisation.
L’objectif est d’assurer une proximité avec tout ce qui concerne l’accompagnement des étudiants dans leur recherche de stage, de contrat d’apprentissage, etc. »
La relation aux entreprises par la recherche
D’après Angela Vasanelli, « il existe de nombreuses opportunités pour développer les relations entre entreprises et universités par le biais de la recherche.
Parmi ces opportunités, il y a bien sûr les projets collaboratifs, qu’il s’agisse de projets ANR Agence nationale de la recherche ou de projets européens. Ces dispositifs fonctionnent très bien, car la nature même de ces collaborations oblige les parties à dialoguer et à adopter un langage commun, avec des objectifs clairs et définis.
Un autre outil important est celui des thèses Cifre, qui impliquent à la fois un établissement académique et une entreprise privée. C’est une excellente opportunité de travailler ensemble sur des projets concrets, en passant par un doctorant ou une doctorante, qui mène des recherches tout en étant encore sous statut étudiant. »
Synchroniser le temps de la recherche et de l’entreprise
Federico Pigni évoque les freins à la collaboration avec les entreprises via la recherche. « En tant qu’université, nous ne sommes pas bien organisés, il y a un risque de dissonance avec le temps de l’entreprise. Lorsqu’un entrepreneur ou un industriel me demande “combien ça coûte ?”, il veut une réponse le lendemain, mais les chercheurs ne fonctionnent pas du tout de cette manière. »
Un autre frein est lié aux publications scientifiques, selon lui : « Un chercheur a des intérêts académiques liés à ses publications, mais ceux-ci ne sont pas toujours compatibles avec les besoins de développement des entreprises. »
« Aujourd’hui, un chercheur est évalué sur le nombre de publications dans des revues classées et son classement dans les revues 4 étoiles ou FT Financial Times . Or, très peu de publications FT concernent des recherches appliquées. C’est pourquoi il faut des profils hybrides, capables de faire le lien entre la recherche et l’entreprise », d’après lui.
Un moyen de développer les ressources propres
« Entre 45 et 50 % de nos ressources proviennent de partenariats et de ressources propres », indique Marie-Christine Bert, pour qui il est « crucial de maintenir un équilibre entre l’engagement de la puissance publique, qui soutient l’enseignement supérieur et la recherche, et les ressources propres, qui proviennent majoritairement des entreprises ».
Federico Pigni fait remarquer que le modèle de recherche de GEM est financé à 100 % par des fonds privés, provenant :
- des frais de scolarité des élèves ;
- mais aussi « de la capacité de nos chercheurs et de notre structure à collaborer avec les entreprises ».
Angela Vasanelli estime que pour les organismes publics, l’objectif des coopérations avec les entreprises n’est « pas de générer des financements, mais bien de structurer un partenariat durable, qui repose sur plusieurs volets :
- donner de la visibilité à nos diplômés, afin de faciliter leur insertion professionnelle.
- créer des relations solides entre les chercheurs et les entreprises, basées sur un modèle non linéaire. »
L’Europe, « bonne échelle » pour structurer les liens entre le monde académique et l’industrie (M-C.Bert)
D’après Marie-Christine Bert, « nous vivons une période où l’Europe est la bonne échelle et la bonne plateforme pour organiser et structurer les liens entre le monde académique et l’industrie. C’est un enjeu crucial pour plusieurs raisons :
- d’une part, pour la soutenabilité de nos institutions. Nous comprenons très bien que cela concerne avant tout le financement. Les subventions publiques pour les écoles et établissements publics ne sont pas vouées à augmenter, ce qui signifie qu’il est essentiel de trouver d’autres sources de financement et de contribuer aux ressources propres ;
- D’autre part, pour les entreprises. Il est fondamental qu’elles puissent coopérer au plus haut niveau en recherche avec nos universités, afin de rester dans la course, mais aussi pour contribuer à la souveraineté industrielle européenne. »
Des cadres européens structurants
« L’Europe propose déjà des cadres structurants pour favoriser cette coopération, notamment à travers les financements universitaires européens et les projets européens », indique Marie-Christine Bert.
Elle prend l’exemple des universités européennes : « À l’École des Ponts, nous sommes fondateurs d’une université européenne spécialisée en ingénierie, Eelisa, qui place l’ingénieur européen au cœur de sa réflexion et de sa mission. Ce qui est très intéressant, c’est que les universités membres de notre alliance ont des approches et des enjeux très différents :
- Nos collègues italiens sont fortement tournés vers l’innovation et la collaboration entre recherche et industrie.
- Nos collègues allemands partagent cette approche.
- Nos collègues espagnols, en revanche, sont moins concernés par la coordination recherche-industrie, mais accordent une grande importance aux stages et à la relation école-entreprise dans la formation.
Ce qui est frappant, c’est que, malgré ces différences, nous parvenons à coopérer et à nous mettre d’accord sur des projets structurants. »